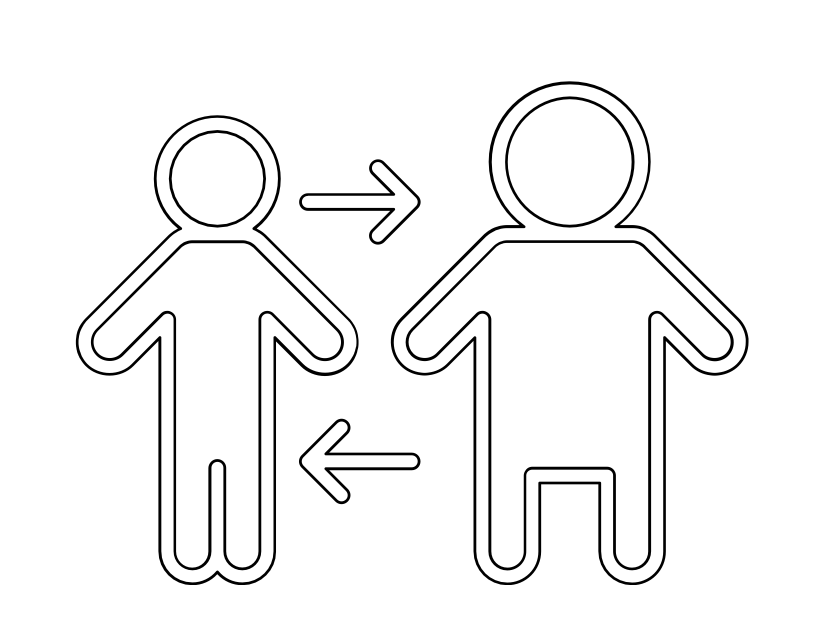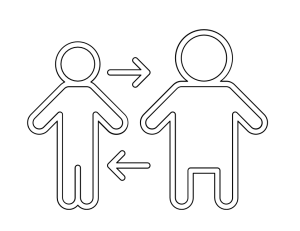
La déglutination : quand les mots maigrissent
La déglutination est l’un de ces mécanismes discrets mais puissants qui façonnent l’évolution d’une langue. Elle consiste en une mauvaise segmentation : la voyelle initiale d’un mot est prise pour une partie de l’article qui le précède. Le mot « maigrit », en perdant son initiale, ou bien, par phénomène inverse, il en gagne une.
Cette erreur d’analyse, d’abord ponctuelle, se généralise à l’oral puis finit par s’imposer à l’écrit. Ce qui n’était qu’une confusion devient une nouvelle norme.
Voici quinze cas précis, riches en histoire et en nuances, pour comprendre comment la déglutination a modelé une partie du lexique français.
1. Orange : du naranj à l’orange
Le mot vient de l’arabe nāranj, transmis par l’espagnol naranj. En ancien français, on disait « une narange ». La proximité avec l’article a conduit à détacher le n, que l’on a rattaché à l’article : « une narange » devint « une orange ».
Cette déglutination est célèbre car elle a donné au français non seulement un nom de fruit, mais aussi un nom de couleur. Contrairement à ce que l’on croit parfois, la couleur n’a pas donné son nom au fruit : c’est bien l’inverse.
2. Aspic : du naspic au serpent
Le latin aspis désignait déjà un serpent venimeux. En ancien français, la forme naspic apparaît. Là encore, l’article « un naspic » a été perçu comme « un aspic », ce qui amincit le mot.
Aujourd’hui, l’« aspic » reste un serpent (notamment dans les textes littéraires), mais le mot s’est aussi étendu à un mets froid en gelée. Ce double sens illustre le destin multiple d’un terme façonné par déglutination.
3. Écrevisse : de la crevice à l’« écrevisse »
Issu du francique krebiz (« crabe »), le mot a d’abord donné crevice en ancien français. Avec l’article, « une crevice » a été entendu comme « une écrevice ».
Le phénomène est d’autant plus intéressant que l’anglais crayfish reprend la même racine germanique, mais sous une autre forme. L’écrevisse française, en quelque sorte, partage une parenté étymologique avec le fish anglais, même si le crustacé n’est pas un poisson.
4. Lierre : du ierre au « lierre »
Le latin hedera a donné en ancien français ierre. Employé avec l’article, « l’ierre » a été réanalysé comme « le lierre », et le l s’est soudé au mot.
Ici, le phénomène fonctionne à l’inverse : on n’a pas perdu une voyelle initiale, on a ajouté une consonne perçue à tort comme partie intégrante. Le lierre est donc un mot « engraissé » par son article.
5. Oseille : de l’azeile à l’oseille
Le mot remonte au latin acetella, diminutif de acetum (« vinaigre »), en raison du goût acide de la plante. En ancien français, il apparaît sous la forme azeile. Mais avec l’article, « l’azeile » devint « l’oseille », par perte du « a » initial.
Ce qui n’était qu’une confusion phonétique a créé un mot stable, toujours vivant aujourd’hui. L’oseille a ensuite pris un sens figuré, « argent », très répandu dans l’argot moderne.
6. Oignon : variations autour d’un bulbe
Du latin unio (« bulbe »), le mot donne en ancien français oingnon. Mais l’usage courant amincit le mot en « ognon », en éliminant l’initiale. Cette forme « ognon » est même officialisée par la réforme orthographique de 1990, sans effacer la graphie plus ancienne « oignon ».
Ce mot illustre la concurrence entre tradition orthographique et simplification phonétique, la déglutination fournissant ici une variante acceptée.
7. Orme : un arbre qui a failli devenir « norme »
Issu du latin ulmus, l’ancien français connaît la forme orme. Mais avec l’article, « un orme » a pu être entendu comme « un norme ». Plusieurs textes médiévaux attestent cette variante.
La langue a finalement conservé la forme « orme », mais ce type de fluctuation montre combien les mots les plus simples pouvaient être remodelés par le jeu de l’article.
8. Olive : de l’oliva à l’olive
Du latin oliva, le mot est emprunté tel quel. Cependant, dans l’usage oral, on trouve des variantes telles que « une nolive » ou même « live », issues d’une réinterprétation fautive de l’article.
Ce qui a triomphé, c’est la forme complète « olive », mais la variété dialectale garde trace des formes déglutinées.
9. Orphelin : le détour par « norphelin »
Issu du latin orphanus, le mot entre en français sous la forme orphelin. Mais dans certains contextes, « un orphelin » a été perçu comme « un norphelin ».
Cette forme, pourtant fautive, a été suffisamment fréquente pour être attestée dans des documents médiévaux. Elle a cependant disparu, preuve que la déglutination ne donne pas toujours des mots durables.
10. Éléphant : le lélefant des anciens textes
Le latin elephas passe en français sous la forme elefant. Avec l’article, « l’elefant » a parfois été réinterprété comme « lélefant », un doublement artificiel de la consonne initiale.
L’exemple montre que la déglutination peut aussi produire une redondance plutôt qu’un amincissement. Finalement, la forme stabilisée fut « éléphant », qui a conservé sa voyelle initiale.
11. Émail : un mot fragmenté
Issu du germanique smalta (« verre fondu coloré »), le mot devient esmail en ancien français. Mais l’usage de « l’esmail » a pu donner « le smail », puis par réduction « mail ».
Le mot a survécu sous ses deux formes : émail pour la matière, et mail dans certains dérivés comme « vitrail » (anciennement « verre d’esmail »). La coexistence des deux témoigne d’une bifurcation étymologique due à la déglutination.
12. Anis : quand « un anis » devient « un nys »
Le latin anisum a donné anis. Dans certaines régions, on a entendu « un anis » comme « un nys », et la forme tronquée a subsisté dans les parlers dialectaux.
Aujourd’hui, seule la forme entière subsiste dans le français standard, mais les formes régionales permettent de suivre le cheminement de l’erreur phonétique.
13. Alouette : la « louette » médiévale
Le mot vient du latin alauda. En ancien français, on trouve alouete. Avec l’article, « l’alouete » est devenu « louette » dans l’usage populaire.
La chanson enfantine « Alouette, gentille alouette » a figé la forme longue, mais dans les textes médiévaux, les deux coexistent. C’est un exemple où la poésie populaire a contribué à la stabilisation du mot.
14. Écarlate : du luxe textile à la couleur
Issu du latin médiéval scarlata, le mot entre en ancien français comme escarlate, désignant un tissu de luxe. Avec l’article, « l’escarlate » devient « l’écarlate ».
Aujourd’hui, le mot ne désigne plus l’étoffe, mais directement la couleur rouge vif. La déglutination a donc contribué à un glissement de sens, en même temps qu’à une modification formelle.
15. Maie : le coffre de cuisine
Issu du latin magida (« pétrin »), le mot est attesté en ancien français sous la forme amaie. Avec l’article, « l’amaie » est devenu « la maie », et le mot a perdu son initiale.
La maie, grand coffre de cuisine servant à pétrir et conserver le pain, est encore connue en français régional. C’est un bel exemple de déglutination qui a produit un mot familier dans le vocabulaire rural.
La déglutination est un cas d’école en linguistique : elle montre comment une simple confusion phonétique peut transformer un mot et redessiner une partie du lexique. Parfois, la forme déglutinée s’impose (orange, écrevisse, oseille), parfois elle disparaît (norphelin). Dans tous les cas, elle illustre la souplesse des langues et l’importance de l’usage collectif dans la fixation des formes.