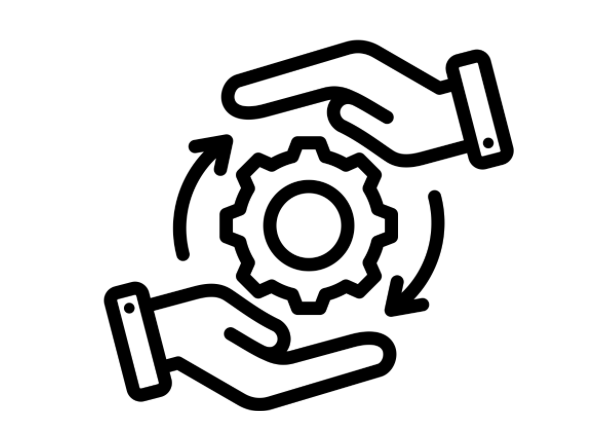
Quand le peuple chamboule les mots
L’étymologie populaire est un phénomène fascinant : en rapprochant deux mots qui se ressemblent par leur forme ou leur sens, les locuteurs créent une nouvelle explication… souvent fausse, mais qui finit parfois par transformer la langue.
Deux effets principaux :
- Changer le sens d’un mot : par exemple, beaucoup croient que morbide signifie « relatif à la mort » à cause de sa ressemblance avec mort, alors qu’il vient du latin morbidus, « maladif ».
- Changer la forme d’un mot : ainsi, infarctus est souvent prononcé infractus, comme si l’on parlait d’une « fracture du cœur ».
Voyons quelques cas où le peuple a réellement chamboulé les mots.
Le chat-huant : un hibou qui miaule
Au XIᵉ siècle, le hibou se disait javan. Le mot évolue en choan, puis en chauan. Au XIIIᵉ siècle, apparaît chat-huant. Pourquoi ? Parce que son cri rappelait celui d’un chat qui hue. Par ressemblance sonore, le hibou s’est transformé en chat-huant.
La choucroute : du chou mais pas de croûte
L’alsacien surkrut (« chou fermenté ») est emprunté en Suisse romande au XVIIᵉ siècle sous la forme surcroute. Arrivé en France, le mot devient sorcrotte, puis choucroute.
La deuxième syllabe a été associée à « croûte » par étymologie populaire : puisque le plat contient du chou, il devait forcément contenir aussi une « croûte ».
De la coutepointe à la courtepointe
Coudepointe venait de coute (« lit de plumes ») et de pointe (de poindre, « piquer, coudre »). C’était une couverture piquée. Mais le mot a été rapproché de court, par analogie : la couverture n’était pas immense, donc c’était une « courte-pointe ».
Fainéant, ou le feignant corrigé à tort
En ancien français, feignant (participe présent de feindre) signifiait « se dérober à une tâche ». Le mot était correct. Mais l’imaginaire collectif a voulu comprendre qu’un inactif « fait néant » : on a créé fai-néant. Cette erreur a supplanté la forme régulière.
Du forsborc au faubourg
Vers 1200, forsborc désignait la partie d’une ville située hors de l’enceinte (fors = « hors », borc = « bourg »). Avec le temps, on a rapproché fors de faux. Un faubourg est donc devenu un « faux bourg » : une interprétation fausse, mais logique.
Forcené : quand la force s’invite
L’adjectif forsenede (vers 1050) signifiait « hors de raison », de for- (« hors de ») et sen (« sagesse »). Quand le mot sen a disparu du français, on n’a plus reconnu sa présence dans forsené.
Le peuple a réinterprété le mot comme lié à force. Ainsi, le forcené est devenu celui qui déborde de force.
La girouette : du nordique au français
Le mot normand wirewire, issu du vieux norrois veðrviti (« instrument à vent »), a été oublié dans son origine scandinave. En français, on l’a rapproché de girer (« tourner »), pirouette et rouet. De wirewire, on est donc passé à girouette.
Infarctus → infractus
Beaucoup prononcent infractus, par analogie avec fracture. L’étymologie populaire imagine une « fracture du cœur », alors que le mot vient du latin infarctus, « farci, rempli » (allusion à une obstruction).
Morbide : de la maladie à la mort
Le mot vient du latin morbidus, « maladif ». Mais par ressemblance avec mort, nombre de locuteurs croient qu’il signifie « relatif à la mort ». Une erreur tenace, héritée d’un rapprochement trop séduisant.
Cerf-volant : du serpent au cervidé
À l’origine, on parlait d’un serp-volant (« serpent volant »), créature imaginaire. Mais le mot a été réinterprété par le peuple : on a cru qu’il s’agissait d’un cerf-volant, probablement en raison de la ressemblance sonore. L’animal fabuleux a changé de nature.
Paresseux : de la lenteur à l’inaction
Le latin pigritiosus signifiait « lent, engourdi ». Passé en français, le mot a pris la forme paresseux. L’étymologie populaire a accentué le lien avec l’idée moderne d’oisiveté : quelqu’un qui « reste paresseusement ». Le sens s’est donc déplacé.
Hérisson : l’animal hérissé
Issu du latin ericius (« porc-épic »), le mot a été rapproché de hérisser. L’image des piquants dressés a imposé ce lien dans l’esprit populaire, donnant au mot son apparence actuelle.
Cagoule : du capuchon à la rusticité
Venant du latin cuculla (« capuchon »), le mot a été transformé par rapprochement avec caguer (« faire ses besoins »). Parce que ce vêtement simple évoquait une rusticité populaire, le mot a pris une coloration péjorative.
L’étymologie populaire agit comme un réparateur spontané de la langue : elle cherche à rendre les mots plus transparents, plus « logiques », même si ce n’est pas leur véritable histoire. Certains de ces bricolages sont restés marginaux (infractus), mais d’autres ont triomphé : qui songerait aujourd’hui que la choucroute ne contient pas de croûte, ou qu’un cerf-volant était autrefois un serpent ?
| Forme ancienne / étymologique | Déformation par étymologie populaire | Forme moderne | Sens actuel |
|---|---|---|---|
| javan → choan (« hibou ») | Rapproché de « chat » + « huant » | chat-huant | Hibou nocturne |
| Alsacien surkrut (« chou fermenté ») | Interprété comme « chou + croûte » | choucroute | Plat de chou fermenté |
| coutepointe (« couette cousue ») | Influencé par « court » | courtepointe | Couverture piquée |
| feignant (de feindre = « se dérober ») | Reanalysé comme « fait néant » | fainéant | Paresseux |
| forsborc (« hors du bourg ») | Associé à « faux » | faubourg | Quartier hors de la ville |
| forsené (« hors de raison ») | Rapproché de « force » | forcené | Fou furieux |
| wirewire (ancien normand, « instrument à vent ») | Rapproché de girer, rouet, pirouette | girouette | Indicateur de vent (ou personne changeante) |
| infarctus (latin = « rempli, obstrué ») | Prononcé infractus, associé à « fracture » | infarctus | Obstruction artérielle |
| morbidus (latin = « maladif ») | Rapproché de « mort » | morbide | « Maladif », puis « malsain » (faussement perçu comme « mortel ») |
| serp-volant (« serpent volant ») | Entendu comme « cerf-volant » | cerf-volant | Insecte (lucane) ou jouet volant |
| pigritiosus (latin = « lent, engourdi ») | Renforcé par « paresse » | paresseux | Oisif, indolent |
| ericius (latin = « porc-épic ») | Rapproché de « hérisser » | hérisson | Animal couvert de piquants |
| cuculla (latin = « capuchon ») | Déformé par rapprochement avec caguer | cagoule | Capuchon couvrant la tête |