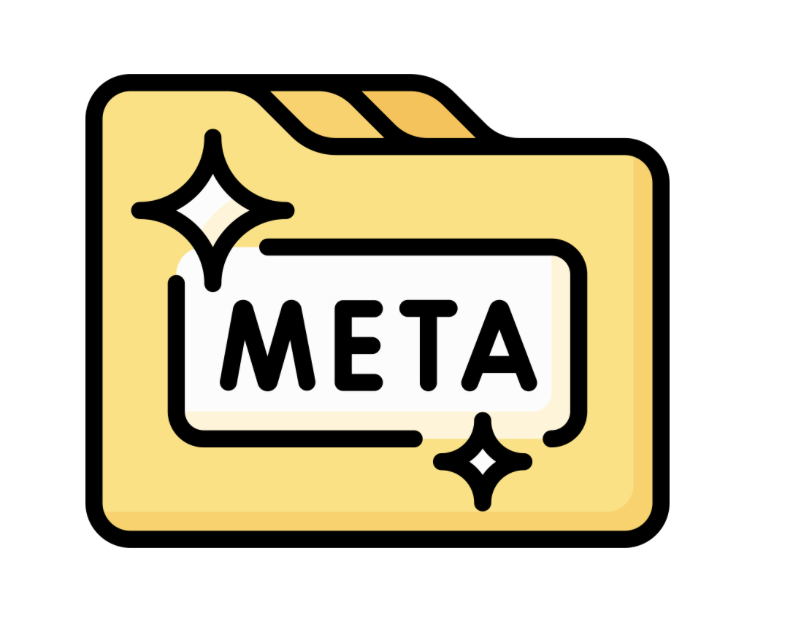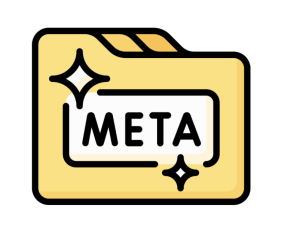
Des mots sens dessus dessous
La métathèse consiste en l’inversion de deux voyelles ou de deux consonnes, voire de deux syllabes, à l’intérieur d’un mot ou d’un groupe de mots. Une utilisation ludique de la métathèse est le contrepet : en faisant un échange entre le ch de champ et le t de coton, on transforme un champ de coton en un temps de cochon. La liste suivante présente quelques mots français qui ont fait l’objet d’une métathèse et que l’usage a gardés.
Le latin vulgaire berbix avait donné le nom berbis, attesté au début du XIIe siècle. Par métathèse, berbis est devenu brebis, mais cela reste un animal très mignon.
À l’origine du nom breuvage se trouve évidemment le verbe boire, ou, plus exactement, ses variantes anciennes que furent les verbes beivre, bevre et boivre. Durant le XIIe siècle, breuvage prit les formes bovrage et beverage, puis on le rencontre en 1450 sous la forme bovrage. Ensuite, la métathèse joua son rôle, et bruvaige est attesté au XVIe siècle, avant de devenir breuvage.
Attesté dans la littérature en 1911, cagibi est la métathèse d’un mot dialectal de l’Ouest de la France, le nom cabigit ou cabagit, qui a pour sens « cahute ».
Le nom latin crocodilus avait aussi la forme cocodrilus, et celle-ci produisit le français cocodrille, attesté au XIIe siècle. On ne sait pourquoi, mais ce cocodrille devint crocodile en 1538. Animal certes dangereux, mais qui aime bien le tennis.
L’adjectif d’ancien français forasche, « sauvage », subit lui aussi une métathèse, puisqu’il devint faroche au XIIIe siècle, avant de prendre la forme farouche que nous connaissons.
Paragraphe gastronomique : le latin disait caseus formaticus, littéralement « fromage moulé », c’est-à-dire formé dans un moule. L’ancien français abandonna caseus, qu’il laissa à ses voisins anglais (cheese) et allemands (Käse), mais conserva formaticus, devenu formage. Toutefois, la métathèse veillait, et c’est ainsi que naquit notre fromage, vers 1135, avec le succès que l’on connaît. On notera que forma, à l’origine de formaticus, est le grand-père de la bien bonne fourme, « fromage bleu du Forez ».
Le latin medulla, « moelle », avait donné les formes meüle, méoule et meole au XIIe siècle. Par métathèse, tout cela devint le nom moelle, attesté durant le premier quart du XIIIe siècle.
Le nom latin mosca, « mouche », a essaumé dans plusieurs langues romanes, notamment en espagnol, où il donna le nom mosquito. Adopté par le français, ce dernier devint mousquite, attesté en 1603, mais, par métathèse, mousquitte devint moustique en 1654, peut-être sous l’influence de tique, puisqu’on était dans le monde des insectes.
Le nom grec glykyrritsa fut modifié par le latin in liquiritia, sous l’influence de liquor. L’ancien français transforma liquiritia en licorece, puis en ricoire ou ricoelce, plus tard encore en régulisse, et enfin en réglisse, probablement sous l’influence de règle, car la réglisse était alors vendue sous forme de longs bâtons.
La première forme du verbe suivre était sivre, attesté en 1080. Sa troisième personne du présent était il siut, qui fut refaite en il suit, par analogie avec les terminaisons des verbes du deuxième groupe. L’infinitif fut également modifié, et la forme suivre apparaît au XIIIe siècle.
Le verbe latin temperare avait donné tempérer, mais aussi temperr, « mélanger », attesté vers 1155. Par métathèse, temperr devint tremper, présent dans un texte de 1306. On pouvait commencer la lessive.
À côté de ces métathèses lexicalisées, il existe quelques mots malmenés par l’usage mais, depuis que les dictionnaires enregistrent et fixent la forme première des mots, ces fantaisies ne deviennent pas la norme. On veillera donc à ne pas dire *aréoplane mais aéroplane, ni *aéropage mais bel et bien aréopage, encore moins *infractus pour infarctus, ni *carapaçon, pour lui préférer le caparaçon.