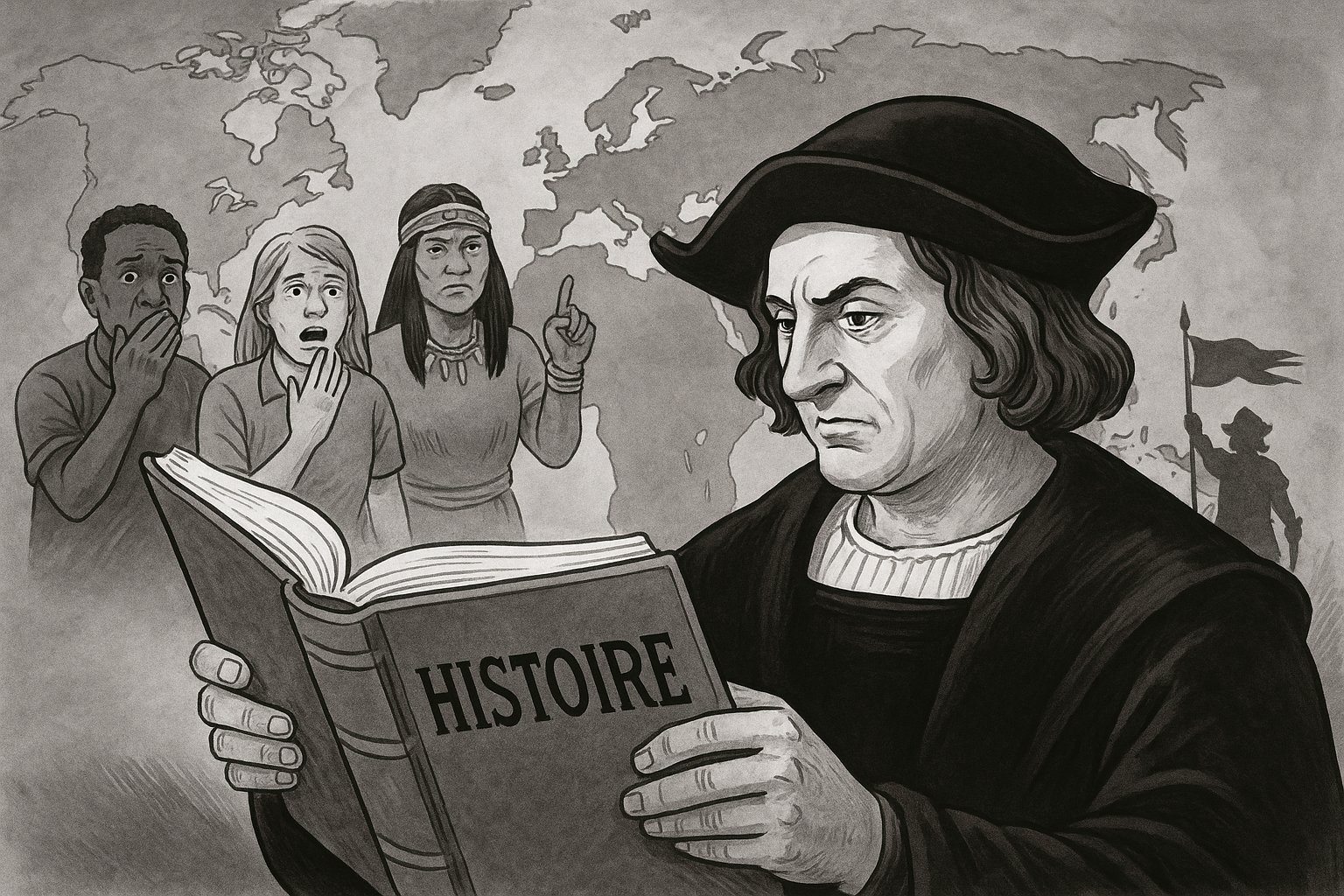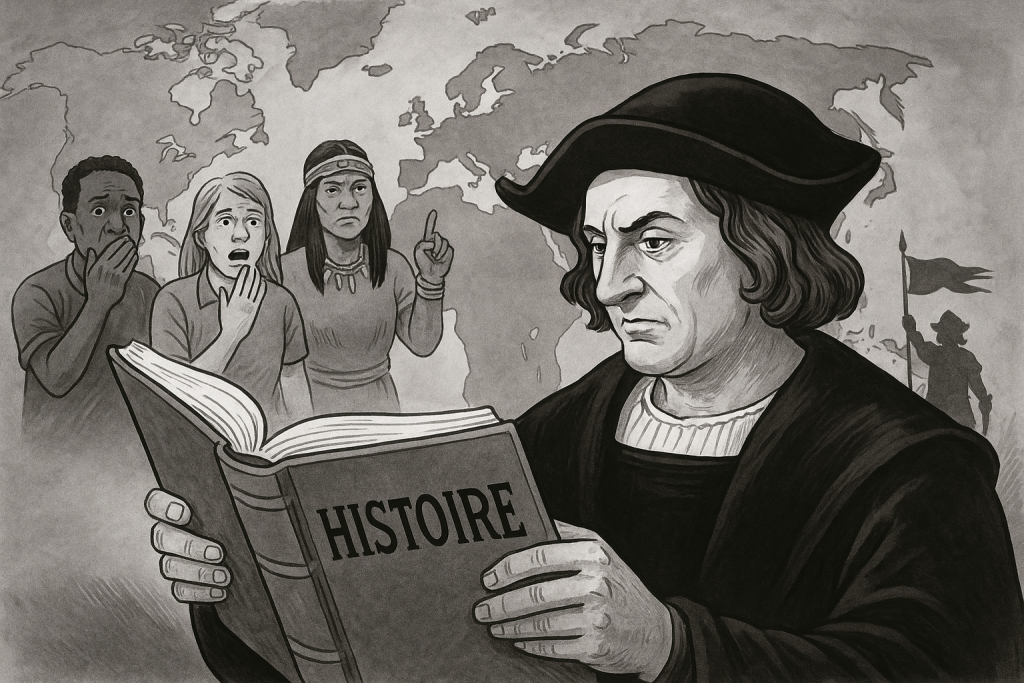
L’histoire enseignée dans les manuels scolaires, notamment sur les grandes « découvertes », repose sur un ensemble de récits figés qui ont façonné la mémoire collective occidentale. Christophe Colomb, en particulier, est présenté comme un héros dont le voyage en 1492 aurait « découvert » un Nouveau Monde. Mais cette vision est largement réductrice, contestable scientifiquement et idéologiquement orientée. L’objectif de cet article est de déconstruire ce récit traditionnel à la lumière de recherches historiques récentes et des critiques sur l’eurocentrisme des manuels.
I. Christophe Colomb : un récit héroïque contesté
Dans la plupart des manuels scolaires, Colomb est présenté comme « l’homme qui a découvert l’Amérique » en 1492. Ce récit, que l’on retrouve dans les ouvrages américains comme The American Adventure ou Life and Liberty, est souvent illustré par des images de caravelles et de marins courageux. Les manuels américains lui consacrent en moyenne un millier de mots, soit un traitement démesuré par rapport à la complexité de la période.
Ce récit présente plusieurs erreurs historiques :
- Il minimise la quête de richesse qui fut la motivation principale de Colomb, comme l’indique l’historien Michele de Cuneo qui écrivait en 1494 : « Il était temps de mettre à exécution son désir de chercher de l’or, principale raison pour laquelle il avait entrepris un si grand voyage. »
- Il ignore les contacts antérieurs avec les Amériques, comme ceux des Vikings au Groenland et à Terre-Neuve (Vinland) autour de l’an 1000. Les explorateurs Thorfinn et Gudrid Karlsefni menèrent une expédition de 205 colons dans cette région, et les Vikings continuaient à explorer jusqu’au Labrador plusieurs siècles plus tard.
- Il passe sous silence les violences et l’esclavage que Colomb a exercés dès son arrivée, comme il l’écrivait lui-même : « Je mènerai la guerre partout et par tous les moyens. Je vous soumettrai au joug et à l’obéissance envers l’Église et envers Sa Majesté. Je prendrai vos femmes et vos enfants pour en faire des esclaves. »
II. Les explorations précolombiennes oubliées
L’histoire des explorations n’a pas commencé avec l’Europe de la Renaissance. Les manuels passent sous silence des faits pourtant documentés :
- Les contacts transatlantiques précolombiens impliquant des Vikings, mais aussi des hypothèses sérieuses sur des voyages phéniciens, égyptiens, voire africains vers les Amériques. Des statues olmèques découvertes au Mexique et des traditions orales en Afrique de l’Ouest soutiennent l’idée de contacts antérieurs.
- Des recherches récentes évoquent des indices archéologiques et biologiques d’échanges transatlantiques avant Colomb, notamment la détection de maladies africaines dans des squelettes brésiliens antérieurs à 1492, ainsi que des témoignages sur des communautés noires établies au Panama avant l’arrivée des Européens.
Cette omission est « d’autant plus ironique », comme le montre l’historien Ivan Van Sertima (They Came Before Columbus, 1976), que des récits médiévaux évoquaient déjà ces traversées possibles, sans parler des explorations asiatiques de l’époque de Zheng He.
III. L’oubli des causes profondes : la domination européenne
Les manuels scolaires ne questionnent que très rarement les causes profondes de la domination européenne à partir du XVe siècle. Plusieurs facteurs sont systématiquement négligés :
- Le progrès militaire (canons, artillerie embarquée, armes de siège) qui fut un élément décisif dans la conquête.
- Le développement d’une idéologie théologique justifiant la conquête au nom de la religion chrétienne : les Européens se considéraient investis d’une mission divine d’expansion.
- La peste bubonique qui, en affaiblissant l’Europe au XIIIe et XIVe siècles, explique en partie la dynamique de conquête économique et territoriale.
L’historien Angus Calder rappelait que « l’Europe était plus pauvre au XVe siècle qu’au XIIIe », ce qui contredit le mythe d’une Europe florissante en quête d’épices.
IV. Les limites du récit eurocentré : vers une histoire plus inclusive
L’absence de ces récits dans les manuels pose la question : pour qui sont écrits ces livres ? Comme le souligne la bande dessinée, ils sont produits « par et pour les descendants de ces Européens ». La glorification des explorateurs européens masque le potentiel et les réalisations des autres civilisations :
- En incluant les explorateurs africains et asiatiques, on enrichit le récit mondial.
- Cela montre le potentiel humain universel, y compris celui des peuples non-européens.
- Cela brise le mythe d’une domination occidentale inévitable ou « naturelle ».
Les critiques adressées aux manuels insistent sur l’importance d’aborder les thèmes des migrations anciennes, des échanges transcontinentaux et des sociétés multiculturelles préexistantes, dans une perspective postcoloniale.
IV. Le récit héroïque : mythe fondateur et falsifications
La plupart des manuels scolaires américains et européens présentent Colomb comme un explorateur visionnaire, courageux et animé d’un esprit scientifique. Cette vision repose sur plusieurs mythes :
- L’idée qu’il aurait découvert que la Terre était ronde, alors qu’au XVe siècle, la rotondité de la Terre était une donnée acquise par la plupart des lettrés.
- La description de Colomb comme un homme désintéressé, motivé par l’exploration et la science, alors que ses écrits et ceux de ses contemporains témoignent de motivations essentiellement économiques et religieuses, principalement la quête d’or et la conversion forcée des peuples rencontrés.
La biographie romancée de Washington Irving en 1828 a largement contribué à fixer cette image fausse en Europe et en Amérique du Nord.
Citations clés :
- Colomb en 1492 : « Je pourrais en conquérir la totalité avec une cinquantaine d’hommes et les gouverner comme il me plairait. »
- Michele de Cuneo : « Il était temps de mettre à exécution son désir de chercher de l’or, principale raison pour laquelle il avait entrepris un si grand voyage. »
V. Des contacts transocéaniques antérieurs : un savoir effacé
Les manuels omettent fréquemment les contacts précolombiens avec les Amériques, pourtant documentés par l’historiographie :
- Vikings : Leif Erikson atteint Terre-Neuve vers l’an 1000.
- Expéditions africaines : des sources et des traditions orales suggèrent que des marins d’Afrique de l’Ouest auraient pu atteindre les côtes américaines avant 1492.
- Phéniciens et Égyptiens : des hypothèses de voyages atlantiques anciens existent, bien que controversées.
Les statues olmèques au Mexique, les traditions africaines et des analyses archéologiques alimentent ces thèses alternatives. Leur absence des manuels révèle un choix idéologique qui fait de l’Europe l’unique acteur de l’histoire mondiale.
VI. La violence coloniale et l’économie de l’esclavage
1. La traite des Arawaks
Dès son premier voyage, Colomb met en place un système de tribut imposé aux Arawaks. Incapables de satisfaire aux exigences en or, ils sont mutilés ou réduits en esclavage :
- En 1495, 1 500 Arawaks sont capturés. 500 sont envoyés en Espagne ; 200 meurent durant le voyage.
- L’esclavage sexuel est pratiqué dès les premières expéditions : dans une lettre de 1500, Colomb mentionne le commerce de jeunes filles de 9 à 10 ans.
- L’encomienda, système d’exploitation coloniale déguisée, est mise en place pour contourner l’interdiction formelle d’esclavage.
Selon Kirkpatrick Sale (The Conquest of Paradise), la population des Arawaks d’Haïti est passée de 3 millions à 12 000 en 1516 et quasiment disparue en 1555. Ce processus constitue un véritable génocide.
2. Le développement de la traite transatlantique
La pénurie d’esclaves indigènes conduit rapidement à l’introduction de la traite transatlantique des Africains. Ce basculement marque un tournant décisif vers la racialisation des populations asservies. Les manuels, en évitant d’associer Colomb à cette traite, oblitèrent une réalité majeure.
Citation clé :
- Bartolomé de las Casas : « Ce fut un règne de terreur qui s’ouvrit en Hispaniola. »
VI. Les résistances indigènes : un récit oublié
L’histoire des peuples autochtones est systématiquement minorée dans les manuels :
- La résistance passive des Arawaks (refus de cultiver, désertion des villages) précède des révoltes armées dès 1495.
- La grande révolte des esclaves d’Haïti en 1519, souvent ignorée, marque pourtant un des premiers soulèvements multiraciaux contre le colonialisme.
La comparaison avec La Guerre des Mondes de H.G. Wells éclaire ce que cette violence signifia pour les peuples autochtones, mis en position de résistance face à un envahisseur technologiquement supérieur.
VIII. L’impact en Europe : la naissance d’une conscience européenne
Les explorations de Colomb ne bouleversent pas seulement les Amériques. Elles provoquent un changement profond en Europe :
- La remise en cause de l’uniformité religieuse : comment intégrer ces peuples absents de la Bible ?
- L’émergence d’une identité européenne par contraste avec les « autres » (les Amérindiens).
- Le développement de justifications racistes pour légitimer l’esclavage.
L’Europe post-1492 voit ainsi naître les concepts de « Blanc », de supériorité raciale et d’expansion chrétienne universelle.
IX. L’histoire scolaire : omissions et fabrication d’un mythe
L’analyse des manuels américains (The American Adventure, Life and Liberty, The American Pageant) montre une tendance générale à édulcorer les faits :
- L’accent est mis sur le courage de Colomb, sa foi chrétienne, son rôle de pionnier.
- Les violences, l’esclavage et la quête de richesse sont minimisés, voire effacés.
Un seul manuel sur douze mentionne explicitement le lien entre Colomb et l’esclavage. Les autres préfèrent « façonner un personnage » permettant de fonder un mythe originel américain.
Citation clé :
- Bill Bigelow : « Les manuels amplifient les récriminations de l’équipage pour faire une quasi-mutinerie, là où les témoignages des sources primaires diffèrent. »
X. L’esclavage et la violence : remettre Colomb dans son contexte sans l’excuser
Les défenseurs du récit héroïque de Colomb insistent parfois sur le fait qu’en 1492, le monde n’avait pas atteint un consensus moral condamnant l’esclavage. Effectivement, certaines sociétés amérindiennes, africaines ou asiatiques pratiquaient l’asservissement sous diverses formes.
Cependant, ce que révèlent les archives, c’est le rôle central joué par Colomb dans l’établissement d’un système d’exploitation à une échelle sans précédent. Le passage de la captation individuelle à la mise en place de l’encomiendapuis de la traite transatlantique marque un tournant fondamental dans l’histoire mondiale.
La dénonciation des violences par des contemporains comme Bartolomé de Las Casas, qualifiant l’esclavage d’« offense impardonnable envers Dieu et l’humanité », montre que des voix dissidentes existaient déjà. Leur omission dans les manuels favorise une identification implicite au conquérant plutôt qu’aux résistants.
XI. Les échanges colombiens : transformation mondiale et débuts du capitalisme
L’impact des voyages de Colomb ne se limite pas à la conquête militaire :
- Le « Columbian Exchange » (A.W. Crosby, 1972) transforme la planète par l’échange d’espèces végétales, animales, de maladies et de populations humaines.
- Près de la moitié des cultures alimentaires mondiales (pomme de terre, maïs, tomate, cacao…) proviennent des Amériques.
- Mais cette transformation s’accompagne d’une montée en puissance du capitalisme marchand européen, d’une inflation monétaire massive et de la paupérisation des économies non-européennes.
La colonisation des Amériques par l’Europe redessine les flux économiques mondiaux au profit d’une nouvelle classe marchande, consolidant la domination occidentale.
XII. Déconstruire les notions de « Nouveau Monde » et de « Découverte »
Les expressions de « Nouveau Monde » et de « Découverte » sont en elles-mêmes porteuses d’un regard colonial. Comment peut-on « découvrir » un territoire habité depuis des millénaires ? Ce langage n’est pas neutre :
- Il légitime l’occupation des terres.
- Il efface les droits et la souveraineté des peuples autochtones.
Le juge John Marshall (1823) justifia l’expropriation des terres cherokees par le concept de « découverte » : cette rhétorique continue d’avoir des implications politiques concrètes.
XIII. Vers une histoire mondiale : reconnaissance des échanges et des résistances
Les dernières décennies ont vu émerger une historiographie plus critique :
- La notion d’échange bilatéral met en avant non seulement ce que l’Europe a apporté aux Amériques mais aussi ce que les savoirs amérindiens, africains et asiatiques ont transmis à l’Europe.
- Des figures oubliées — marins, traducteurs, agriculteurs autochtones, médecins africains — ont joué un rôle crucial dans ces premiers contacts transatlantiques.
Comme le rappelle William Erasmus, autochtone du Canada : « Ces explorateurs que vous appelez “grands hommes” étaient impuissants sans nous. »
XIV. Le rôle des manuels scolaires : entre omission et mythe identitaire
L’analyse des manuels révèle des tendances lourdes :
- L’idéalisation de Colomb reflète une histoire blanche (white history) qui perpétue l’idée d’une supériorité morale et intellectuelle de l’Europe.
- L’effacement des noms et des points de vue autochtones réduit ces peuples au statut d’« autres » sans individualité ni voix.
- Le mythe du « choc des cultures » résume à tort la conquête à un affrontement inéluctable entre « civilisations » au lieu de reconnaître la multiplicité des interactions, des résistances et des alliances.
XV. Pour une histoire critique et inclusive
Repenser le récit de Colomb invite à :
- Abandonner la notion de « découverte » au profit de celle de rencontre, de conflit et de transformation mutuelle.
- Réintroduire les voix autochtones et africaines dans les récits historiques pour leur redonner leur place légitime dans l’histoire mondiale.
- Enseigner l’histoire dans sa complexité, en évitant le manichéisme des héros sans tache et des « sauvages » sans visage.
L’histoire de Christophe Colomb n’est pas seulement celle d’un navigateur. C’est celle d’un basculement mondial, aux conséquences toujours visibles dans les inégalités contemporaines. Comprendre ce passé, sans le simplifier ni l’excuser, est une condition essentielle pour penser le monde globalisé du XXIe siècle.
Bibliographie détaillée
- Abulafia, David. The Discovery of Mankind: Atlantic Encounters in the Age of Columbus. Yale University Press, 2008.
- Boorstin, Daniel J., and Kelley, Brooks Mather. The Discoverers. Random House, 1983.
- Crosby, Alfred W. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Praeger, 1972.
- Las Casas, Bartolomé de. A Short Account of the Destruction of the Indies. 1552. (Nombreuses éditions modernes)
- Sale, Kirkpatrick. The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Legacy. Knopf, 1990.
- Van Sertima, Ivan. They Came Before Columbus: The African Presence in Ancient America. Random House, 1976.
- Weatherford, Jack. Indian Givers: How Native Americans Transformed the World. Fawcett Columbine, 1988.
- Zinn, Howard. A People’s History of the United States. Harper & Row, 1980.
- Greenblatt, Stephen. Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. University of Chicago Press, 1991.
- Pagden, Anthony. European Encounters with the New World: From Renaissance to Romanticism. Yale University Press, 1993.